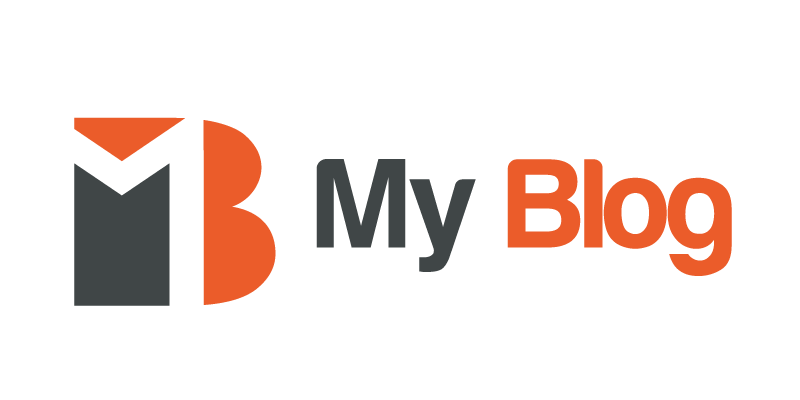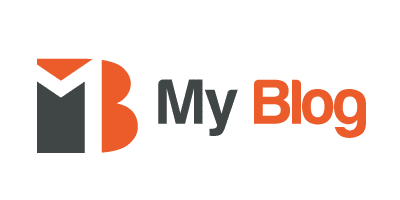Un poste d’AESH, c’est un contrat de trois ans, souvent à durée déterminée, sans garantie de stabilité à l’issue. Accéder à un CDI implique de répondre à une condition d’ancienneté stricte, mais paradoxalement, une formation spécifique n’est pas toujours demandée lors du recrutement. Les perspectives d’évolution restent limitées, malgré une demande forte dans les écoles et des responsabilités qui ne cessent de grandir sur le terrain. Les candidats doivent accepter une grille salariale peu dynamique et des horaires parfois hachés, signes d’une profession indispensable, mais encore largement marquée par la précarité.
AESH : un rôle essentiel dans l’école inclusive
Dans chaque salle de classe, la présence de l’aesh s’impose comme un pilier de l’inclusion scolaire. Ici, accompagner un élève en situation de handicap ne se limite ni à l’assistanat ni à la surveillance passive. L’aesh construit une relation de confiance, ajuste son soutien selon les besoins, favorise l’autonomie et encourage la participation de l’enfant à tous les temps de la vie scolaire.
Mandaté par le ministère de l’éducation nationale, l’accompagnant éducatif et social travaille avec les élèves pour lesquels le projet de scolarisation indique clairement la nécessité d’un accompagnement. Parfois appelé AVS (auxiliaire de vie scolaire), il agit en lien direct avec les équipes pédagogiques, facilitant l’accès au savoir, adaptant les supports, valorisant chaque initiative, et veillant à la sécurité comme au bien-être de l’élève.
Voici les principales missions confiées à un AESH :
- Contribuer à la mise en place et au suivi du projet personnalisé de scolarisation.
- Développer des stratégies d’accompagnement adaptées à chaque forme de handicap.
- Instaurer un dialogue entre l’enfant, les enseignants et les familles.
L’aesh s’inscrit dans un travail d’équipe : il coopère avec les enseignants, d’autres accompagnants spécialisés, et parfois du personnel médico-social selon les situations. Cette collaboration lève les barrières, ouvre l’école à la pluralité des parcours et donne à chaque élève la possibilité d’avancer. Sur le terrain, la reconnaissance de ce métier, forgée par l’expérience au quotidien, reste un défi à relever pour toute la communauté éducative et les acteurs de l’inclusion.
Quelles sont les missions et responsabilités au quotidien ?
Auprès d’élèves en situation de handicap, l’accompagnant éducatif installe une présence discrète mais essentielle. Son rôle ne s’arrête pas à l’aide technique : il veille à l’inclusion dans la vie de la classe, soutient les apprentissages, encourage l’autonomie, adapte si besoin les supports pédagogiques. Chaque journée implique de s’ajuster en continu aux besoins spécifiques, en lien avec le projet personnalisé de scolarisation élaboré par une équipe pluridisciplinaire.
Les tâches à assurer au quotidien se répartissent ainsi :
- Accompagnement dans les gestes de la vie courante : soutien à la mobilité, gestion du matériel, facilitation de la communication, aide pendant les repas ou lors des déplacements dans l’établissement.
- Soutien pédagogique : reformulation des consignes, adaptation des exercices, encouragement à la participation orale et écrite, gestion de l’attention.
- Relais avec l’équipe éducative : transmission d’informations sur les progrès ou difficultés, participation active aux réunions avec enseignants, familles et parfois services médico-psycho-pédagogiques (CMPP).
L’aesh agit toujours en concertation avec les enseignants, les familles et d’autres professionnels spécialisés. Son sens de l’écoute, sa capacité à observer et sa discrétion font la différence pour ajuster chaque accompagnement. Exercer ce métier demande de la souplesse, une rigueur sans faille et un engagement réel auprès des élèves et de l’inclusion scolaire.
Les étapes clés pour accéder au métier d’AESH
Devenir aesh implique de suivre un parcours structuré, avec des exigences claires en matière de formation et de recrutement. Le premier critère : posséder le diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social (DEAES) ou justifier d’une expérience solide dans l’accompagnement de personnes en situation de handicap. Si le diplôme fait défaut, la validation des acquis de l’expérience (VAE) permet de faire reconnaître officiellement son parcours professionnel.
Le recrutement s’effectue via l’éducation nationale : chaque académie propose ses offres, principalement en ligne, et demande un dossier de candidature comprenant notamment une lettre de motivation argumentée. Le premier contrat proposé est généralement un CDD, avec la perspective d’un passage en CDI après plusieurs années de service validées.
Le dispositif prévoit une formation d’adaptation à l’emploi de soixante heures, prise en charge par l’institution. Par ailleurs, le compte personnel de formation (CPF) peut servir à financer un complément de qualification. Accéder à ces formations suppose d’être organisé et de bien anticiper les démarches.
Voici les grandes étapes à respecter pour se lancer dans la fonction :
- Obtenir le DEAES ou justifier d’une expérience dans l’aide à la personne
- Constituer un dossier complet pour l’académie (CV, lettre de motivation, justificatifs)
- Suivre la formation initiale obligatoire
- Bénéficier d’un accompagnement lors de la prise de poste
La réussite du parcours repose sur une gestion administrative rigoureuse, une motivation solide pour soutenir les élèves dans leur scolarité et une réelle aptitude à travailler collectivement.
Évolutions professionnelles et perspectives d’avenir
Le métier d’aesh ne se limite pas à l’accompagnement quotidien. D’autres perspectives s’ouvrent, encore trop peu connues, où la formation continue joue un rôle central. L’expérience de terrain, la maîtrise des outils pédagogiques et la participation à des équipes pluridisciplinaires constituent des atouts pour envisager une mobilité interne.
Obtenir le diplôme d’État par la VAE permet notamment d’accéder à des fonctions plus larges, dans le secteur médico-social ou au sein des collectivités territoriales. Après plusieurs années d’expérience, la transformation d’un CDD en CDI offre enfin une stabilité souvent recherchée, mais encore peu fréquente.
Reste la question du salaire et des indemnités, qui continue de faire débat. Le niveau de rémunération demeure bas, même si des revalorisations ont été annoncées par le ministère de l’éducation nationale. L’évolution salariale dépend en partie de l’ancienneté, mais aussi d’une prise de responsabilités ou d’une orientation vers d’autres métiers de l’accompagnement vie et de l’assistant de vie.
Pour enrichir leur parcours, plusieurs options s’offrent aux AESH :
- Intégrer des équipes médico-sociales
- Se préparer aux concours de la fonction publique
- Se former pour accéder à des postes d’auxiliaire de vie ou d’accompagnement personne
La profession s’adapte, portée par une demande croissante d’inclusion scolaire et la reconnaissance progressive du métier d’AESH en France. Face à ces évolutions, chaque accompagnant trace sa propre voie, entre défis quotidiens et promesse d’un avenir plus stable pour l’école inclusive.